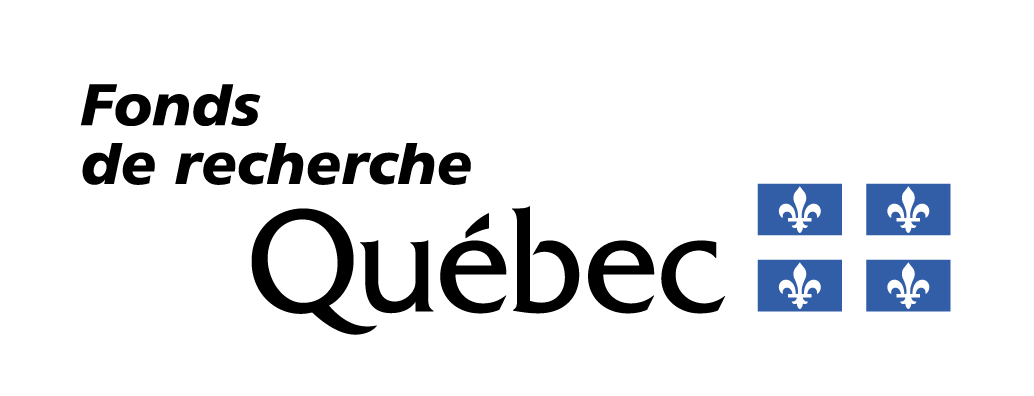La transition vers une économie circulaire au Québec
Le 25 septembre, la pause du midi sera l'occasion de prendre connaissance de l'état de la circularité au Québec. Notez que le webinaire sera en anglais.
Depuis 2014, le Québec est le fer de lance de la transition vers une économie plus circulaire et la province est sans doute devenue un chef de file en matière de circularité au Canada et en Amérique du Nord. Alors que la première voie du Québec vers la circularité reposait sur des initiatives de recherche inter- et transdisciplinaires, dans la période 2021-2025, le Québec a de plus en plus été un laboratoire ouvert pour l’émergence de la cocréation et de nouveaux modèles d’affaires, ainsi que pour le développement d’initiatives multipartenariales entre les mondes de la recherche.
Bien que des défis demeurent, l’approche collective du Québec en matière de circularité se démarque : Le Québec s’est doté d’un cadre réglementaire, d’une feuille de route gouvernementale, d’un vocabulaire commun et d’une approche sociétale qui accélèrent l’adoption de ce modèle économique.
Le rapport Transitioning to a Circular Economy in Québec: Consolidation (2021–2025) documente les principales étapes et initiatives de la période mise en lumière. Dans ce webinaire, Stéphanie Jagou, consultante en circularité et auteure, entend présenter l’engagement progressif du gouvernement envers la circularité, la façon dont les villes et les régions ont commencé à travailler vers des objectifs d’économie circulaire, la contribution de l’économie sociale et la cocréation de solutions avec le milieu universitaire dans la transition vers ce nouveau modèle économique, tout en mettant en lumière divers projets dans des secteurs industriels clés – parmi lesquels les systèmes alimentaires, le textile, le plastique, les matériaux avancés et le tourisme. Après avoir mis l’accent sur le potentiel circulaire dévoilé par l’Écosystème de laboratoires d’accélération en économie circulaire (ELEC) du CERIEC, comprenant le Lab construction, Raphael Lopoukhine, directeur des initiatives stratégiques de la CELC, présentera à son tour la manière dont le Circular Construction Innovation Hub (CCIH) relève le défi de libérer le plein potentiel de la construction circulaire au Canada et ses derniers développements.
A propos des conférenciers
Stéphanie Jagou évolue dans les domaines du développement durable et de l’économie circulaire depuis près de 20 ans. De l’ONG à la PME en passant par la multinationale et le monde académique, elle a dirigé de nombreux mandats au Canada, en Europe et en Nouvelle-Zélande, et a participé à de nombreux projets de développement (Haïti, Gabon, Costa-Rica). Collaboratrice à différents titres dans l’écosystème de la circularité au Québec depuis 2016, chargée de cours et formatrice, elle est actuellement Consultante en économie circulaire à HEC Montréal, au RRECQ et au CERIEC (Centre d’études et de recherche intersectorielles en économie circulaire).
Raphael Lopoukhine est un leader politique et stratégique spécialisé dans l’innovation en matière d’économie circulaire dans les secteurs de la construction et de l’environnement bâti au Canada. En tant que directeur des initiatives stratégiques au sein de Circular Economy Leadership Canada, il joue un rôle central en réunissant les leaders de l’industrie, les décideurs politiques et les innovateurs pour accélérer le changement des systèmes vers des solutions circulaires à faible émission de carbone.
Avec une formation en journalisme environnemental, en politique gouvernementale et en recherche basée sur la conception, Raphael a conseillé des ministres, dirigé des communications sur le climat pour des organisations nationales et rédigé des rapports sur la conception des systèmes et la politique sur les systèmes de matériaux de construction circulaires. Il apporte près de 20 ans d’expérience en matière de politique climatique et circulaire, de communication et de conception, notamment au sein du ministère de l’Environnement de l’Ontario, de Passive House Canada et du Bureau des villes intelligentes de la ville de Guelph.
Raphael est titulaire d’un Master of Design in Strategic Foresight and Innovation de l’Université OCAD et d’une maîtrise en journalisme de l’Université de Colombie-Britannique. Il est passionné par la transformation des grandes idées en stratégies réalisables qui remodèlent l’avenir de notre environnement bâti.
Revoir le webinaire
Pour aller plus loin
Liens partagés pendant le webinaire
- Transitioning to a circular economy in Québec : consolidation 2021-2025
- Feuille de route pour la transition vers une économie circulaire de la société québécoise à l’horizon 2050
- Plan de mise en oeuvre 2025-2028 de la Feuille de route gouvernementale en économie circulaire 2024-2028
- Québec Circulaire
- Generate Canada
- Circular Economy Leaders
- Building Canada’s Circular Economy Knowledge Base: Inventories of Circular Economy Policies and Initiatives
- The Circular Built Environment in Canada: A Strategic Framework for Future Action
- Circular Construction Innovation Hub
Foire aux questions
Réponses aux questions posées pendant le webinaire
- Comment passer d’initiatives ponctuelles à un véritable impact systémique en économie circulaire ?
Avec une taxe sur les déchets progressivement croissante et sans incidence sur les recettes, qui donne aux entreprises une certitude quant au coût de la mise en décharge au fil du temps, associée à une série de politiques de soutien visant à aider les entreprises et les gouvernements à adapter leurs activités pour répondre à ce changement important de fin de vie, afin de garantir la mise en place des infrastructures nécessaires pour faciliter les activités de réutilisation, de réparation, de remise à neuf, de refabrication, de réutilisation, de recyclage et de valorisation tout au long de la chaîne de valeur. À partir de là, le renforcement des normes, des incitations et des exigences en matière d’approvisionnement créerait une demande stable pour les produits et matériaux circulaires, tandis que l’obligation de transparence et de partage des données tout au long des chaînes d’approvisionnement accélérerait la mise à l’échelle. Sans cette combinaison de signaux économiques en hausse constante et de mesures habilitantes coordonnées, nous resterons bloqués dans des projets pilotes et des engagements volontaires plutôt que d’obtenir un impact systémique. En outre, afin d’éviter les conséquences imprévues de nouvelles initiatives qui ne s’inscrivent pas dans une perspective systémique et de cycle de vie, il est essentiel de donner la priorité à la formation à l’économie circulaire et à l’accompagnement sur le terrain, qui bénéficient d’un financement dédié.
- Le gaz naturel renouvelable (GNR) s’inscrit-il réellement dans l’économie circulaire ?
Il est vrai que le méthane est un gaz à effet de serre très puissant et que sa capture pour être utilisé comme RNG ne crée pas un cycle « circulaire » des matières au sens strict du terme. Cela dit, si les matières organiques émettent déjà du méthane, sa capture et sa combustion pour produire de l’énergie peuvent réduire les impacts climatiques à court terme par rapport au rejet, au torchage ou à la combustion de gaz naturel vierge. Une véritable stratégie circulaire pour les matières organiques donnerait la priorité à la prévention et aux utilisations de plus haut niveau : réduction des déchets alimentaires, alimentation animale, compostage, régénération des sols et bioproduits. Le RNG devrait être considéré comme le dernier échelon de cette hiérarchie, utile pour les résidus inévitables, mais ne pouvant se substituer à une circularité systémique.
- Pourquoi le taux de circularité au Québec demeure-t-il si bas (3,5 %) malgré les efforts des dernières années ?
Les changements sociétaux peuvent prendre des générations. Passer d’une économie linéaire à une économie circulaire implique de modifier de nombreuses règles et mentalités, et ne peut se faire de manière isolée. D’un point de vue général, une grande partie du travail préparatoire nécessaire a été accompli au Québec au cours de la dernière décennie. Pour progresser, il faut un cadre gouvernemental clair, et le Québec vient seulement de publier sa feuille de route et son plan d’action.
Remarque : À titre informatif, le taux de circularité du Québec n’est pas comparable au taux de circularité canadien, car des méthodes différentes ont été utilisées pour les calculer.
- Le concept d’une installation de recyclage résidentielle pourrait-il être appliqué à l’industrie de la construction et de la démolition ? Qu’est-ce qui retient l’industrie de le faire ?
Oui. Les MRF de construction et de démolition fonctionnent déjà dans certains endroits, ce qui prouve que le modèle peut fonctionner. Elles récupèrent le bois, les métaux, le béton et les cloisons sèches dans les chargements mixtes. Ce qui freine l’industrie dans la majeure partie du Canada est simple : l’élimination en décharge est trop bon marché, la réglementation est faible, les marchés pour les matériaux récupérés sont limités, et les constructeurs sont motivés par la rapidité et le coût plutôt que par le détournement. Le modèle réussit lorsque les prix des décharges augmentent, que les gouvernements imposent le détournement et que des marchés fiables pour les matériaux récupérés se développent. Sans ces conditions, la mise en décharge reste l’option la plus facile.
- Comment encourager le partage de données sur les flux de matières (traçabilité) ?
Le partage d’informations est en effet la base d’une mise en œuvre efficace de la circularité dans de nombreuses entreprises et secteurs. C’est ce que font les agents de Synergies au niveau local. Il faut un environnement de communication où les organisations se sentent en sécurité (en termes de concurrence commerciale) pour partager des données critiques afin de faire progresser la circularité et d’échanger des flux de matières.
- Comment le Québec et le Canada se préparent-ils au passeport produit numérique (DPP) de l’Union Européenne ?
Le passeport numérique des produits de l’UE va remodeler le commerce mondial en faisant de la transparence et de la circularité des conditions préalables à l’accès au marché. Pour le Canada et le Québec, les exportateurs devront de plus en plus prouver comment les produits sont fabriqués, ce qu’ils contiennent et comment ils peuvent être réutilisés ou recyclés. Les exportations canadiennes les plus menacées sont les métaux, les matériaux de construction, les plastiques, les meubles et les textiles, car ces secteurs seront parmi les premiers à être soumis aux exigences strictes de l’UE en matière de transparence, de circularité et de performance carbone. Cela signifie que les chaînes d’approvisionnement devront devenir plus transparentes, les systèmes de données plus robustes et la conception des produits plus circulaire. Il n’est pas certain que les régulateurs aient vraiment pris conscience de l’impact de cette réglementation. Dans la pratique, le passeport nous aidera à faire valoir que la durabilité n’est pas un argument marketing, mais une exigence du marché.
- Le design pour l’adaptabilité peut-il soutenir l’économie sociale ?
La conception axée sur l’adaptabilité est de plus en plus reconnue en architecture. Au Québec, le projet Les Ateliers Cabot à Montréal, lauréat du prix C40, illustre comment une conception adaptable peut soutenir l’économie sociale grâce à des pratiques circulaires axées sur la communauté. Voir le projet
- Existe-t-il une feuille de route pour améliorer le taux de circularité du Canada (6,1 %) ?
Il n’y en a pas. N’hésitez pas à contacter le ministre de l’Environnement actuel pour lui faire part de vos suggestions sur la manière dont cette question devrait être examinée : ministre-minister@ec.gc.ca Remarque : à titre d’information, le taux de circularité du Québec n’est pas comparable au taux de circularité canadien, car des méthodes différentes ont été utilisées pour les calculer.
- L’association entre économie circulaire et économie sociale peut-elle freiner l’investissement privé ?
Une des raisons possibles de ces réactions réside dans la manière dont l’économie sociale, en particulier les entreprises d’économie sociale (EES), a traditionnellement été promue, souvent sans mettre en avant ses principaux impacts économiques ou ses connexions réseau plus larges. Cette situation évolue rapidement au Québec, où les acteurs de l’économie sociale mettent de plus en plus en avant ses impacts positifs et où le soutien gouvernemental semble renouvelé. Ces efforts pourraient s’avérer cruciaux pour surmonter le scepticisme et les perceptions négatives.