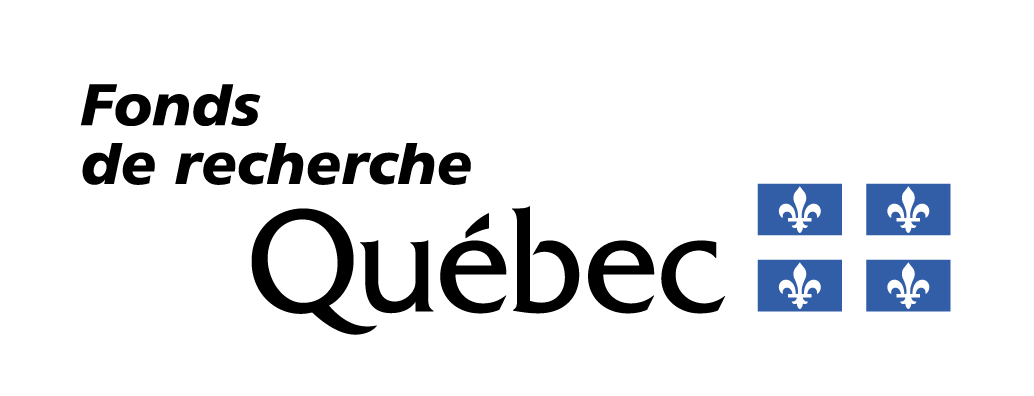La doctorante Ambre Fourrier et le professeur Éric Pineault explorent le recyclage comme un processus social, mettant en lumière l’invisibilisation du travail domestique, l’inclusion en centres de tri et la précarisation des travailleurs migrants. Découvrez le résumé de leurs travaux.
Résumé
Alors que l’on aperçoit de plus en plus de logos sur nos produits de consommation et que l’on parle de « bonne gestion » de nos déchets, trop peu d’études s’attardent à documenter la diversité des pratiques manuelles impliquées dans ces processus de circularité. Les discours sur l’économie circulaire tendent à invisibiliser les personnes permettant, par leur travail quotidien, de détourner des matières de l’enfouissement. En ce qui concerne le « recyclage », celui-ci implique une diversité de pratiques socio-culturelles (habitudes, gestes, production/consommation), d’infrastructures (transports, centre de tri, etc.) et un marché (courtier, recycleur, etc.). Rappeler cette évidence, est une manière de faire valoir que le processus ne se limite pas aux caractéristiques chimiques de la « matière » mais qu’ilimplique l’ensemble de la société. Cette réalité crée d’ailleurs une tension puisque les différentes dimensions susmentionnées restent spécifiques à chaque territoire (national) alors même que les « matières », elles, circulent sur un marché international principalement comme support d’emballage de nos produits de consommation.
Percevoir le recyclage en tant que « processus social », permet aussi de révéler que la « chaine de valeur », tant souhaitée par les promoteurs de l’économie circulaire, commence par un travail de « reproduction » c’est-à-dire un travail effectué au sein de la sphère privée, non rémunéré et non considéré comme tel (Simonet, 2018 ; Federici, 2021). Ainsi, à même les foyers, ce sont davantage les femmes qui ont le « souci-du-devenir-des-déchets-quotidiens ». Ce constat, se base sur une analyse – en cours de traitement – effectuée sur la base de forums de discussion sur le web et est largement confirmé par la littérature (Wilde, M. de, & Parry, S, 2022).
Faire ce premier constat invite à être critique des discours qui se limitent à mettre l’accent sur la « sensibilisation du population », sans jamais reconnaître la difficulté de ce « travail ». Pourtant, nous suggérons qu’une première étape pour lutter contre « l’écofatigue » (Observateur de la consommation responsable, 2023), serait de reconnaître la complexité de la tâche de tri trop souvent considérée comme étant simple. Dans les faits cette tâche – surtout à cette étape – nécessite une bonne connaissance de la réalité du milieu en perpétuel changement, car il s’agit d’apprendre une taxonomie particulière, elle-même très sujette aux fluctuations du marché.[1]
« Reconnaître la valeur de ces activités permettrait à celles qui les accomplissent d’obtenir un véritable statut et davantage de gratifications, tout en incitant les autres groupes sociaux à prendre également leur part de ce travail.» (Glenn, 2000).
Par ailleurs, cette démarche de « purification de la matière » – autre manière de nommer le recyclage – se poursuit à la périphérie des villes, au sein des centres de tri. Parmi les infrastructures présentes sur le sol québécois, on retrouve de nombreuses entreprises adaptées (Investissement Québec, 2021). Ces organisations nous ont ouvert leurs portes pour entamer notre ethnographie participante. Ces organisations ont pour spécificité d’être inclusives dans leurs pratiques organisationnelles, travaillant avec les personnes neuro-atypiques qui sont bien souvent éloignées du marché du travail. Elles ont été à l’avant-garde de ce que l’on appelle aujourd’hui l’économie circulaire, mais ne servent pas assez de modèle pour envisager l’avenir, en particulier à l’heure de la mise en place de la responsabilité élargie du producteur (REP). Pourtant, elles apparaissent exemplaires en matière de santé et de sécurité du travail, ce que nous documenterons dans une partie de notre thèse.
Le manque de main d’œuvre (envirocompétence, 2021) conduit le secteur à faire appel à des programmes « de travailleurs migrants temporaires » (Soussi, 2015), comme c’est déjà le cas dans le secteur agricole ou dans les activités de soin à domicile. Cette réalité peu visible est à prendre en considération lorsqu’il s’agit de réfléchir aux « emplois verts ». Le fait que ce soient des personnes marginalisées qui occupent ce type de poste se traduit par une « double dévalorisation » de l’activité (Glenn, 2000) et d’un déficit de reconnaissance (Honneth, 2004) alors même qu’ils ou elles disposent de connaissances importantes. C’est ce que notre thèse en cours visera en partie à démontrer.
[1] Même si actuellement les choses sont en train d’être simplifiées avec l’apparition de la (REP) pour les emballages, elles suscitent encore beaucoup de questions de la part des citoyens et citoyennes.